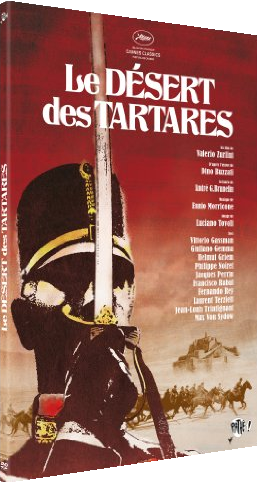![Prod DB © DR Menahem GOLAN, producteur israelien ne en 1929]()
Durant les années 80, âge d’or du duo Menahem Golan-Yoram Globus affectueusement surnommés Mémé et Yoyo, aller voir une de leurs productions estampillées Cannon Group, c’était la garantie d’une déchirure cinéphilique : le cinéphage de bon gout galopait ventre à terre pour assister à un spectacle plein d’action avec la sensation quasi systématique de s’être quand même fait un peu avoir. Si les productions des cousins israéliens regorgeaient bien de bagarres, de coups de flingues et d’explosions, les films avaient des budgets de série B, ceux aux financements plus importants peinaient avec des scénarios sommaires, on se doutait qu’une bonne part du pognon alloué allait dans les poches de vedettes par l’odeur du billet vert alléchées. Les films puaient parfois aussi du bec. C’était l’ère du reaganisme, c’est-à-dire une ère étasunienne tournée vers le néocapitalisme florissant, dont les hérauts étaient les yuppies, une ère de politique nationaliste, réactionnaire et socialement mortifère. L’heure sonnait des ultimes coups de boutoir envers le communisme russe, la stratégie de La Guerre des Etoiles valait ses pesants de milliards. Le cinéma populaire de la nation faisait pas mal dans le musclé. On se bousculait pour voir des trucs comme Top Gun, Cobra, Rocky IV, L’Affaire Chelsea Deardon, Liaison Fatale…
Aller voir une production Cannon relevait du plaisir coupable (revendiqué dans des fanzines papier bien avant l’avènement d’Internet pour tous), au même titre que de prendre un ticket pour un bis italien ou de mater avec des potes à peine remis de leur acné agressive une de ces zèderies en cassette vidéo dont les philippins avait le secret. Si l’amateur sait bien que Menahem Golan a réalisé quelques bons divertissements (dont Lepke le caïd), produit des films d’auteurs comme Love Streams de, défendu des cinéastes comme Andrei Konchalovsky (qui fera pour la Cannon les excellents Runaway Train, Maria’s Lovers et Le Bayou), proposé une poignée de bandes de propagande sionistes (Opération Thunderbolt, Delta Force), c’est tout de même surtout pour les dizaines de dingueries produites que l’homme, un as dans le monde des bateleurs « hollywoodiens », restera dans les mémoires. Norris, Stallone, Lundgren, Bronson, Van Damme et autres fers de lance du cinéma boumboum lui doivent une partie financièrement en or massif de leur carrière, leur début de célébrité ou une dernière partie de carrière punchy.
Producteur qui ne dépareillait pas dans ces années d’ascension des frères Weinstein, de Joel Silver et autres Don Simpson, Mémé régalait chaque année la croisette cannoise d’affiches grand format, surbooké par sa recherche de fric, de faire signer des contrats de prévente, parlant avec passion de projets qui ne se ferait jamais, même à des fanzineux dont votre humble serviteur fit partie. Opportuniste louant Israël dans Opération Thunderbolt alors que les cadavres du raid sur Entebbe dans la nuit du 3 au 4 juillet 1976 sont à peine mis en terre (mais il est grillé au poteau par Irvin Keshner avec Raid sur Entebbe et par Marvin Chomsky avec Victoire à Entebbe), quasi créateur du film de Ninja occidental dont les amoureux des nanars ne se sont toujours pas remis (sous-genre que fréquentèrent Franco Nero, Sho Kosugi, Michael Dudikoff…), faisant de Charles Bronson le doyen des flics violent et des justiciers éradicateurs, sculptant dans le marbre la figure marmoréenne du tout sauf progressiste Chuck Norris, poussant à bout sa logique schizophrène d’homme d’affaires affamé et de défendeur d’un cinéma « exigeant » en produisant un film de Jean-Luc Godard puis passant avec ledit Godard du tout-sourire à la menace de lui refaire le portrait, dealant quelques bons coups avec Albert Cyborg Pyun (qui le suivra quelques temps dans l’aventure de la 21th Century, la boite à Mémé post Cannon), Menahem Golan fut l’un des grands animateurs de ces dirty eighties en roues libres. Et pis, alors que l’homme, souvent conspué par la presse il y a un quart de siècle et plus, est encore invité ici et là dans des festivals où il tient une place d’honneur, alors que lui sont consacrés des documentaires dont au moins un devrait sinon sortir sur quelques grands écrans, du moins être disponible en DVD d’ici la fin de l’année, voilà ti pas qu’il va rejoindre dans nos boites à souvenirs David Carradine, Ted Post, Karen Black, Michael Winner, Ed Lauter, Dennis Farina, Eli Wallach, Run Run Shaw, James Garner et quelques autres personnalités ayant passées l’arme à gauche ces temps derniers.
Laurent Hellebé
Et pour faire bonne mesure, place maintenant à quelques perles produites par la Cannon sélectionnées avec amour et nostalgie par la rédaction.
Kinjite, sujets tabous (1989) de Jack Lee Thompson
![kinjite_aff]()
Production Cannon de 1989 emballée par Jack Lee Thompson pour Charles Bronson, Kinjite, sujets tabous est un polar atterrant, extraordinairement con et raciste. Peut-être traumatisé de rôles plus sobres pourtant déjà trois ans auparavant (La Loi de Murphy, Act of Vengeance), ou totalement inconscient de ce qu’il fait, Bronson incarne un flic blasé et violent chassant un gang de macs et de violeurs de mineurs. Dans la scène d’ouverture, il donne une correction à un amateur de sadomasochisme avec mineure et conclut la branlée en enfonçant dans le suspect pris en flag un godemiché dans l’anus ! Que la fin de cette action soit hors champ ne change rien, le cri du mécréant ne laisse pas de doute. Le reste est à l’avenant. Si les dialogues sont vulgaires, l’ensemble fait montre d’un racisme antijaponais primitif (en plein boum économique massif, les hommes d’affaires japonais des années 80 achètent beaucoup aux USA, comme le feront plus tard leurs homologues chinois et moyen-orientaux. Le cinéma répercute donc ce fait, via par exemple Die Hard et Soleil levant).
![kinjite_01]()
Cela débute par quelques saynètes dans le bureau d’une firme de Tokyo où les employés apprennent les coutumes décadentes des Américains avant d’être envoyés sur place pour s’emparer des affaires les plus rentables (la VF en rajoute une couche). L’un de ces yuppies nippon s’envole pour les USA où il se vautre dans la luxure et des fantasmes le poussant à passer la main sous la jupe d’une adolescente blanche dans un bus, provoquant un début de lynchage d’autres asiatiques qui n’y sont pour rien. Tiens donc, l’adolescente est la fille de l’inspecteur joué par Bronson. Dès lors, celui-ci s’en prend à tout ce qui est bridé. Exemple, lorsque le héros discute avec son collègue dans leur voiture de fonction : « Un citron pourri de l’intérieur tripote ma fille… ces bridés sont partout, ils achètent nos immeubles, nos affaires… ». Après quoi, il engueule des Asiatiques dans la rue en leur disant qu’ils ne sont « pas à Tokyo mais à Los Angeles » et qu’ils « lui bouchent la vue et les pores de la peau » ! Consterné, il doit enquêter sur la disparition d’une ado japonaise, ô hasard la fille du pervers pépère bouffeur de riz. La pauvrette est enlevée, violée à répétition et louée à des sadiques des deux sexes par le gang de proxos que Bronson course depuis le début. À la fin, Bronson chope le chef de gang et le fait entauler dans une section de prison pleine de bourrins mastocs (apparition de Danny Trejo à ses débuts) qui bavent de joie à la vision de la chair fraîche. Du très douteux portnawak pour finir ou commencer la soirée en « beauté ».
Laurent Hellebé
Lifeforce (1985) de Tobe Hooper
![lifeforce_aff]()
Avec Lifeforce, les trublions de la production Menahem Golan et Yoram Globus se lancent dans l’exploration de la science-fiction avec une démesure qui ne leur est pas tellement habituelle, eux qui se sont faits connaître essentiellement avec des productions à petits budgets. Ils se procurent les droits pour l’adaptation d’un roman célèbre parmi les amateurs du genre, Les vampires de l’espace du Britannique Colin Wilson, paru en 1976, et y injectent quelques 25 millions de dollars – une belle somme pour l’époque. Les Vampires de l’espace fut aussi le titre du film tout au long du tournage et jusqu’à la phase de promotion, avant que les deux cousins, soucieux de ne pas donner l’impression d’une énième production de bas étage, en changent pour quelque chose de plus « prestigieux », ou du moins de plus sérieux : ce sera donc Lifeforce, titre ronflant à souhait et définitivement culte.
Impossible de ne pas penser, en regardant Lifeforce, que les producteurs de la Cannon ont essayé de créer une sorte de film-somme, un résumé point par point de tout ce qui fait l’essence de la science-fiction dans son sens le plus large. Gothique autant que fantastique, ce long-métrage, généreux dans sa forme comme dans son extravagance assumée, alterne joyeusement les séquences les plus rocambolesques en empilant les références plus ou moins heureuses, tout en jouant avantageusement avec la plastique irréprochable d’une toute jeune Mathilda May – à poil le plus clair du temps – qui rapproche invariablement le film de la récréation pour geeks avant l’heure. Après une ouverture en fanfare en guise de space opera, le récit lorgne franchement du côté du vampire movie, mâtiné d’invasion zombie, avant de se clore sur une débauche d’effets spéciaux et une séquence finale flirtant avec le romantisme gothique.
![Lifeforce1]()
L’argument en est le suivant : la navette spatiale Churchill, sous le commandement du colonel Tom Carlsen (Steve Railsback), est chargée de s’approcher de la comète de Halley pour l’observer. Découvrant un étrange vaisseau attaché à la queue de la comète (en forme… d’artichaut !), l’équipage se rend à bord pour découvrir un objet complètement mort, à l’exception de trois caissons contenant chacun un être humanoïde plongé en état d’hibernation, qu’ils ramènent vers le Churchill. La Terre ayant perdu tout contact avec le Churchill envoie une navette de secours, et ne trouve à l’intérieur de l’aéronef que des cadavres, une capsule de sauvetage disparue ainsi que les trois caissons, qu’ils descendent sur la terre ferme. Le docteur Hans Fallada (Frank Finlay) se rend compte que l’occupante de l’un des caissons est une sorte de vampire qui absorbe la force vitale des humains. Revenu vivant sur Terre, le colonel Carlsen raconte l’incroyable histoire du Churchill, contaminé par les humanoïdes vampires, et fait équipe avec le colonel Colin Caine (Peter Firth) pour empêcher les vampires de l’espace d’étendre le chaos au monde entier.
![Lifeforce2]()
Pour mettre en scène ce grand délire visuel, Golan et Globus font d’abord appel à Michael Winner – qui décline pour aller s’occuper du troisième d’opus d’Un justicier dans la ville – avant de jeter leur dévolu sur Tobe Hooper. Tout auréolé du succès de Poltergeist, produit par Steven Spielberg, Hooper signe avec la Cannon un contrat pour mettre en scène trois films ; les deux suivants seront L’Invasion vient de Mars (remake du Invaders From Mars de William Cameron Menzies) et Massacre à la tronçonneuse 2, sortis tous deux en 1986. Pour le scénario, ils engagent Don Jakoby et Dan O’Bannon – l’influence de celui-ci, coauteur du script d’Alien, se fait ouvertement sentir dans la séquence d’ouverture où l’équipage du Churchill explore le vaisseau extraterrestre abandonné. Confrontés à un scénario qui a connu au minimum huit versions différentes avant qu’ils ne posent les doigts dessus, les deux compères verront malgré tout leur boulot retouché par Michael Armstrong et Olaf Pooley, alors que le tournage a déjà démarré.
Poussé par les effets spéciaux très réussis de John Dykstra, Lifeforce enchaîne des morceaux de bravoure qui rappellent successivement Alien, Star Trek (le premier opus cinéma est sorti en 1979), L’Invasion des profanateurs de sépulture, Zombie et autres joyeusetés du même tonneau – sans jamais, certes, égaler ses modèles, mais qu’importe : l’important reste que le cinéphage y trouve parfaitement son compte, qu’il s’agisse de découvrir un certain Patrick Stewart (le futur capitaine Picard de la série Star Trek : The Next Generation et futur professeur Xavier des X-Men) dans une étonnante scène d’hypnose, de profiter d’une séquence impressionnante de réanimation d’un vampire-zombie passant de trépas à vie en absorbant l’énergie vitale d’un camarade, ou d’assister à un finale à l’émotion palpable. Le tout illustré par une bande originale signée Henry Mancini, pour sa seule incursion dans ce genre – loin des scores qu’il composa pour les films de Blake Edwards.
![Lifeforce3]()
Sorti en même temps que le Cocoon de Ron Howard, qui a remporté la victoire de la fréquentation haut la main, Lifeforce n’a pas obtenu le succès escompté par le duo de la Cannon. Colin Wilson se plaindra même allègrement de la nullité d’un film qui est progressivement passé dans la catégorie gentillette du nanar – à tort, certainement. Reste que l’un des plus grands cinéphiles de notre époque ne tarit pas d’éloge, et avoue même l’avoir visionné plusieurs fois à sa sortie : Quentin Tarantino aura sans doute été subjugué, comme nous le sommes tous, par la prestation doublement ( ! ) fascinante de Mathilda May. Avec la présence au générique de Golan et Globus, cela fait donc au moins quatre bonnes raisons de découvrir Lifeforce, si possible entre potes et avec une bonne dose de plaisir adolescent.
Eric Nuevo
Le DVD du film est récemment sorti chez Sidonis
Portés disparus 2 (1985) de Lance Hool
![portésdisparus2_aff]()
Un camp de prisonniers quelque part au Vietnam. Chuck Norris suspendu à un arbre par les pieds. Un soldat vietnamien prend un sac de jute, y introduit un rat affamé et excité quelques secondes auparavant. Il pose et noue le sac autour de la tête de Norris. Le prisonnier américain se débat. L’animal pousse des petits cris rageurs. Le sac – imbibé de sang – vire progressivement au rouge écarlate. Les autres soldats prisonniers baissent les yeux, certains de la mort de leur compatriote lorsque celui-ci-devient immobile. Le Viet-Cong retire le sac, et le spectateur découvre alors – en même temps que les protagonistes de la scène – l’animal mort, entre les dents du soldat.
Chuck Norris : 1. Le rat : 0.
Pour beaucoup de cinéphages nourris aux films d’action des années 1980, la Cannon c’est ça : des scènes cultes qui restent irrémédiablement et profondément dans les mémoires – mais aussi dans les cœurs – des gamins qu’ils étaient à cette époque. Qu’importe si lesdits métrages se révèlent au final médiocres, tant ils représentent une part essentielle de notre cinéphilie. L’histoire du cinéma s’est construite avec des 2001 : l’odyssée de l’espace, des Rio Bravo, des Chinatown, etc. Mais certaines séries B y ont également toute leur place. Et force est de reconnaître que Golan et Globus s’y connaissent en matière de série B.
![Portés disparus 2_01]()
Deuxième volet des aventures du colonel James Braddock (Chuck Norris, pour ceux qui ne suivent pas), ce Portés disparus 2 est en fait la préquelle de Missing In Action (1984), titre original du premier métrage – et de toute la saga, close en 1988 par un Portés disparus 3 réalisé par Aaron Norris, le propre frère de Chuck, qui officiait comme coordinateur des cascades sur les deux premiers films. Dans le premier métrage (réalisé par Joseph Zitto), Braddock partait en mission diplomatique au Vietnam, accompagné de bureaucrates tous exécrables à ses yeux, afin de clarifier la question des soldats américains déclarés « portés disparus » depuis la fin du conflit et qui seraient gardés prisonniers dans des camps secrets par le régime vietnamien. Insatisfait de la tournure que prennent les pourparlers entre les deux délégations, le colonel Braddock préfère retourner sur le terrain et revient triomphant avec les prisonniers qu’il a libérés.
Le succès du film provoque illico la mise en chantier d’un nouveau métrage, Missing In Action II : The Beginning, qui relate donc la première aventure de Braddock en territoire vietnamien. Braddock et quelques uns de ses frères d’armes sont depuis 1972 retenus prisonniers dans un camp dirigé par le colonel Yin, interprété par Soon-Tek Oh. Si le métrage respecte certains codes du film de prison (« sous-genre » cinématographique qui fascine tous les amateurs de cinoche d’exploitation), il bifurque assez rapidement vers le film de torture, sans pour autant préfigurer la vage des Torture Porn des années 2000, car les sévices sont avant tout psychologiques et non physiques. Entre autres réjouissances additionnelle à la mythique scène du rat : le jeu cruel de la roulette russe, un soldat américain agonisant brûlé vif, l’humiliation d’un prisonnier déshabillé devant deux prostituées hilares, etc. Surtout, Yin aura la mauvaise idée de foutre en rogne Braddock en lui faisant miroiter une lettre prétendument écrite par sa femme et qui lui est destinée, avant de la brûler sous ses yeux. Braddock va alors devenir son pire cauchemar. Car comme le dit un des nombreux Chuck Norris Facts : « Tous les soir, les cauchemars font le même Chuck Norris ».
![Portés disparus 2_02]()
Ingénieux et clairvoyant (il simule son suicide pour tromper ses geôliers, et ne se laisse pas berner par les astuces de ses ennemis pour l’attirer dans un piège), Braddock fait preuve d’un sens de l’honneur à toute épreuve. Il refuse de reconnaître les crimes de guerre dont l’accuse le colonel Yin, et – héros du film oblige ! – revient sauver seul ses anciens compagnons de cellule après sa spectaculaire évasion. A contrario, les Vietnamiens sont présentés comme des individus sadiques, au vu du plaisir qu’ils prennent à torturer ces braves américains qui n’ont fait que se battre pour leur pays (hum…), et aussi cupides. En sus de leurs activités récréatives sur les soldats US, ils s’adonnent également au lucratif trafic d’opium, en cheville avec un mercenaire français dénommé François (un Français ayant le mauvais rôle dans un film américain, c’est étonnant, non ?). Par le portrait qu’il fait des Vietnamiens, sans nuance ni demi-mesure, Portés disparus 2 devient in fine une caricature aussi drôle qu’inacceptable moralement et politiquement parlant. La scène de combat final entre Braddock et Yin révèle l’opposition des traits de caractères et des valeurs des deux hommes, et implicitement des deux peuples.
N’importe quel fan hardcore de Chuck Norris n’a jamais pu accepter sa défaite contre Bruce Lee dans le finale de La Fureur du dragon – sa seule défaite au cinéma par ailleurs. Norris obtient enfin sa revanche, lors du combat final contre Yin, au cours duquel il pourra déployer toutes ses facultés d’artiste martial hors pair. Rappelons que l’homme a créé sa propre école de karaté aux États-Unis et obtenu de nombreux trophées, avant de se consacrer quasi-exclusivement au cinéma. Finalement, en écho au film réalisé par Bruce Lee en 1972 (soit un an avant le retrait unilatéral des troupes US au Vietnam, et deux ans après le décès d’un des frères de Chuck sur le front), la victoire de Braddock contre Yin dans Portés disparus 2, c’est un peu symboliquement la revanche de l’occident sur l’orient.
![Portés disparus 2_03]()
Résumons : d’un côté des Américains courageux, opiniâtres, avec le sens des valeurs et notamment celui de l’honneur – l’Américain collabo Nester, interprété par cette vieille trogne de Steven Williams, connaît la rédemption en se rebellant contre ses nouveaux maîtres et en se sacrifiant pour ses compatriotes à la fin du métrage. De l’autre des Vietnamiens rapaces, pervers et vicieux, preuves de leur immoralité présentée sinon comme naturelle du moins culturelle. Difficile de dresser un portrait plus manichéen du monde, mais nul doute que cette peinture de la géopolitique mondiale ne plaise à tous les thuriféraires d’un soit disant « choc des civilisations ». Sous couvert d’un métrage célébrant un patriotisme exacerbé, c’est une certaine idée des États-Unis qui se dessine dans cette saga du colonel Braddock, conforme d’ailleurs aux préférences politiques de Chuck Norris, qui n’a jamais caché ses accointances avec le parti républicain – sa frange la plus radicale qui plus est.
Dès le milieu et la fin des années 1970, le cinéma US a su traiter de la question de la guerre du Vietnam, aussi bien frontalement en situant le conflit au cœur de l’intrigue (Voyage au bout de l’enfer, Apocalypse Now, parmi les plus fameux et connus de ces films de guerre) que symboliquement. Inutile par exemple de revenir sur le sous-texte politique et social de Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, sur les écrans américains en 1974. Or le premier Missing In Action ne sort qu’un an après le succès mondial du Rambo de Ted Kotcheff, qui stigmatisait lui-aussi la guerre du Vietnam à travers le prisme du sort réservé aux anciens combattants à leur retour au pays. Par le biais de la saga des Portés disparus, la Cannon opère un virage nettement à droite, même si cela ne signifie pas que Golan et Globus épousent les vues réactionnaires et guerrières des néoconservateurs américains. Les deux producteurs étaient surtout dotés d’un sens commercial qui les rendaient capables de fleurer les bons filons. À ce titre, ils savaient s’adapter au contexte politique, social et économique et produire des films qui étaient « dans l’air du temps ».
En pleine Reaganmania, la Cannon savait qu’elle pouvait capitaliser sur le retour d’un sentiment néo-impérialiste américain, convaincu que les États-Unis avaient à nouveau la mission d’intervenir dans le monde entier, politiquement et aussi militairement. Cependant, en 1986, Golan et Globus produisent Massacre à la tronçonneuse 2, toujours réalisé par Tobe Hooper, au discours férocement anti-Reagan. La preuve que les deux producteurs ne confondent pas politique et cinéma. Ce qui les intéressent avant tout, c’est de tourner des films et – accessoirement c’est quand même mieux ! – réaliser de substantiels bénéfices. Ce qui ne signifie pas qu’ils mégotent sur la qualité de leurs productions. Beaucoup de leurs films, et c’est le cas de Portés disparus 2, sont techniquement bien torchés comme on dit. Des films à la mise en scène solide et également bien montés (expression à double sens totalement assumée !). Deux qualités essentielles pour un film d’action, comme la Cannon en produira des dizaines. Des films de série B. Oui certes. Mais des bons films de série B !
Fabien Le Duigou
Bande annonce version originale :
Bande annonce version française (admirez d’ailleurs le sous-titre vraiment pourri du film en français. No comment) :
Avenging Force (1986) de Sam Firstenberg
![avenging force]()
Parmi les musclés de l’ère Cannon Group comme Van Damme, Norris, Lundgren, Bronson dont la carrière fut mise en orbite ou relancée, il est une star incontestable de ces séries B désormais oubliée, Mickael Dudikoff. Certes, il était plutôt limité dans son interprétation et ses capacités de combattant martial mais son indéniable charisme aurait dû en faire un solide candidat à la fanchise Expendables réunissant les vieilles ganaches de l’action des années 80. Les productions dans lesquelles il était la vedette n’ont jamais eu de retentissants succès en salles comme ses aînés mais il atteint une certaine renommée auprès des cinéphages écumant assidûment les vidéo-clubs pour assouvir leurs penchants pour les bandes testostéronées à l’extrême. Solide gaillard au regard d’acier et mâchoire carrée, véritable archétype ambulant du G.I (le Casper Van Dien des eighties), Dudikoff chassa le cacheton dans des séries télé pour payer ses études de pédopsychiatrie et finalement pris goût au métier d’acteur malgré une sévère dyslexie qui l’handicapait salement pour retenir ses textes. Repéré par Mémé, il devint un des protégés de la firme qui sut maximiser au mieux ses maigres talents. Une belle gueule qui avec les années devint plus à l’aise dès lors qu’il fallait lever la jambe même si ça manquait de souplesse et d’énergie. Néanmoins, il mérite une place de choix au panthéon des spécialistes du bourre-pif car il fut après tout la figure emblématique de la ninjasploitation occidentalisée qui sévit ces années là . Lancé par L’Implacable ninja, il est surtout l’inoubliable héros de la franchise American Ninja retitrée chez nous American Warrior. Une nouvelle étiquette qui sera à l’origine d’un cocasse imbroglio éditorial où même un ninja ne retrouverait pas ses shurikens. Le premier American Warrior (American Ninja en V.O, donc) est mis en scène par Sam Firstenberg avec en vedette le pendant B movies du duo Mel Gibson / Danny Glover, Michael Dudikoff et Steve James dont l’alchimie est aussi opérante bien que fonctionnant essentiellement via la complémentarité de leurs muscles saillants. Le film suivant, Avenging Force, est également réalisé par Firstenberg avec Dudikoff et James mais n’a absolument rien à voir avec la série American Ninja. Avenging Force est envisagé à l’époque comme une suite directe à Invasion U.S.A (1985 – Joseph Zito), Dudikoff remplaçant Norris dans le rôle du héros, Matt Hunter. Même réalisateur et interprètes suffisent au distributeur français pour en faire un nouvel opus d’American Warrior et l’intituler American Warrior II : La Chasse. Problème, la suite d’american Ninja sera mise en chantier l’année suivante, ce qui obligera à le renommer en France Le Ninja Blanc. En 1989 sort American Ninja 3 sans Dudikoff remplacé par David Bradley qui sera distribué sous le titre d’American Warrior 3, une certaine logique dans l’incohérence qui sera jetée aux oubliettes à l’occasion de la sortie un an plus tard d’American Ninja 4 qui débarquera dans les bacs vidéo français sous l’appellation Force de frappe !
![hum, une pause s'impose pour reprendre ses esprits dans un tel bazar...]()
hum, une pause s’impose pour reprendre ses esprits dans un tel bazar…
Mais peu importe, quel que soit son lien, Avenging Force est un film à part du fait de son sujet et surtout la violence que celui-ci implique et qui fait l’obejt d’une monstration ou d’une suggestion assez effarante.
Ici, pas d’intrigue fantaisiste où un américain élevé parmi les ninjas vient faire le ménage. Le récit plus âpre implique un groupuscule de suprémacistes s’insinuant au sein des sphères du pouvoir politique et financier de l’Etat de La Louisiane et dont le noyau dur de quatre hommes s’adonne à des chasses à l’homme récréatives où ils peuvent laisser libre cours à leur plus bas instincts. Ainsi qu’à leur goût pour les déguisements. Costumes plutôt pas mal qui permettent de définir visuellement la caractéristique de chacun (un sniper, un simili gladiateur cagoulé, un The Shape à sabre en tenue de camouflage. Seul le chef devra faire état de son coup spécial pour éclaircir son mode opératoire). Le prologue montrant une de leur partie de chasse donne ainsi le ton du métrage.
Glastonburry, le leader de cette congrégation, voit d’un très mauvais oeil que Larry Richards (Steve James), un noir (!!) brige le poste de sénateur. Il organise ainsi une tentative d’assassinat pendant la parade de carnaval. Attentat déjoué grâce à l’intervention de son pote Matt Hunter (Dudikoff). Enfin pour partie car dans la fusillade, son fils aîné perd la vie. Rangé des services secrets et vivant dans un ranch avec sa soeur et leur grand-père, Hunter reprend contact avec ses anciens employeurs à la C.I.A pour en apprendre un peu plus sur les commanditaires connus sous le nom de Pentangle. Afin de protéger son ami et le reste de sa famille, Hunter les installe au ranch sous la protection de plusieurs agents montant la garde. Rien qui ne puisse arrêter ce Pentangle qui s’adonne alors à un véritable jeu de massacre afin d’éliminer leur cible et surtout approcher ce blanc bec progressiste qu’ils verraient bien comme nouvelle proie. Et afin de le motiver, ils enlèvent sa sœur. Ce qui va fonctionner au-delà de leurs espérances puisqu’il sera passablement énervé.
![avengingforce_01]()
Le manichéisme est vraiment porté à un haut point d’incandescence, les gentils sont vraiment très bons (trop cons ?) se précipitant dans le piège qui leur est tendu en tout connaissance de cause, les bad guys sont vraiment méchants, ils n’ont absolument aucune pitié. Ce qui nous vaut des scènes graphiques assez gratinées puisque lors de l’attaque du ranch, personne ne sera épargné. Les agents se font dessouder comme à la foire, la famille du politicien black se fait exécuter sans sourciller, ce dernier péri dans l’incendie provoqué et son fils survivant n’y réchappe pas non plus ! Pourtant, Hunter tente tout pour le sauver des flammes mais le Pentangle attend qu’il soit sur le toit pour lui harponner la jambe d’une flèche ce qui provoque un déséquilibre fatal pour le gamin qu’il tenait dans les bras. Il est ainsi victime d’une chute impressionnante dont il ne se relèvera pas et malgré tout assez comique puisque l’on perçoit clairement que le gosse a été remplacé par un mannequin. Hunter sera complètement seul lorsqu’il pénètrera sur le territoire de ses ennemis pour récupérer sa sœur et leur faire la peau. On décèle clairement une modification de ton avec le changement d’environnement, passant d’une série B balisée en milieu urbain à un survival dans le bayou. Ainsi, Hunter parvient à retrouver la trace de sa sœur dans un village perdu au milieu des marais peuplé de dégénérés où elle est destinée à la prostitution. Le trait est d’autant plus noirci que subsiste une certaine ambiguïté sur le traitement qu’elle a pu subir avant d’être apprêtée pour ses premiers clients.
Enfin l’affrontement avec ces pourris de racistes aura lieu dans le bayou, sous une pluie battante, donnant un joli cachet à ces séquences solidement réalisées. Ce n’est pas non plus une extase visuelle comparable au Predator de John McTiernan mais c’est carré et une certaine tension s’instaure. Hunter y sera salement malmené et devra puiser dans ses dernières ressources pour en réchapper et les éliminer. La fin ouverte ne donnera jamais lieu à de suite. Bien dommage car cet Avenging Force est un divertissement tout à fait respectable, à cent lieues des nanars du genre dont la Cannon avait le secret.
Nicolas Zugasti
Retour sur le passage de Charles Bronson à la Cannon
![unjusticierdanslaville2_aff]()
Plaidoyer pour l’auto-justice, film fondateur du Vigilante Movie, Death Wish (ou Un Justicier dans la ville par chez nous ) de Michaël Winner, sort en 1974 et remporte un franc et inattendu succès dans une Amérique traumatisée par une guerre perdue et rêvant de justice voire de vengeance. Pour les bons soins de Dino de Laurentis, Charles Bronson, dont la carrière américaine retrouva alors un second souffle après un exil européen pas toujours convaincant, y incarne un quidam moyen dont la vie bascule du jour au lendemain suite au meurtre sauvage de son épouse et au viol de sa fille. Dézinguant à tour de bras et de flingue des brigands qui ne méritaient que ça, il devient progressivement un héros urbain, une légende encensée par les uns et pourchassée par les autres. Bénéficiant d’une réalisation efficace, Death Wish reste sans conteste l’un des meilleurs polars urbains des années 70 malgré un discours inécoutable par certaines têtes pensantes. Bref, un polar brillant par sa forme même s’il reste hautement discutable par son fond.
Malgré l’étonnant succès du premier volet il faudra toutefois attendre sept longues années pour voir le couple Winner/Bronson remettre le couvert sous la houlette d’un Menahem Golan sentant le bon filon se profiler. Devant le refus de Bronson de se faire violer ( certains critiques certifiront que c’était même inscrit dans son contrat !), un subterfuge, que l’on qualifiera pour être gentil de grossier, sert alors de scénario. Paul Kersey reprend donc du service suite au second viol et à l’horrible décès de sa fille tout juste sortie d’un coma consécutif à sa première agression ! Face à des services de police complétement impuissants et qui n’ont après tout pas que ça à faire, il tue tous les responsables de ce crime. Si le premier volet de cette série peut faire partie d’un vidéothèque idéale, le deuxième opus frise la caricature tant le jeu d’acteur de Bronson devient monolithique (genre je fais une grimace dès que je vois un noir, un homo ou un junkie ) et fini par venir flirter dangereusement avec des thèses réactionnaires racistes voire fascistes que ne renieraient pas les plus fervents adeptes de la N.R.A..
![lejusticierdenewyork_aff]()
Poussant le filon jusqu’au bout, Charlie Bronson, Mika Winner, Mémé Golan et son compère Yoyo Globus sortent quatre ans plus tard un troisième opus où Kersey vient vivre, imaginez un peu, dans le quartier le plus pourri de la ville la plus dangereuse. Le Justicier de New York nous révèle alors un Bronson usé, investi d’une mission exterminatrice et porteur d’un magnum phallique du plus bel effet, flinguant du punk, du drogué, du dégénéré, sous le regard complice et bienveillant de la police municipale. Caricatural d’un plan à l’autre, culminant dans un final grotesque où pépé Bronson nettoie le quartier avec un bazooka qu’il peine à porter, la troisième partie de Death Wish signe un suicide filmique rarement vu sur les écrans que ne parviendront pas à ressusciter les films dispensables venant clore cette série.
Vous l’avez compris, si l’un des gros mérites de Golan est d’avoir permis à l’immortel interprète d’un des sept mercenaires originels d’avoir une seconde carrière aux États-Unis, l’une de ses plus grosses tares de producteurs aura été d’avoir enfermé une des plus belles gueules de cinéma dans le rôle d’un justicier réac et raciste au jeu d’acteur tellement pauvre qu’à côté de lui Jean-Claude Vandamme fait figure de prétendant sérieux à l’Oscar du meilleur acteur.
![lejusticierdeminuit_aff]()
Malgré tout, dans cet océan de médiocrité que constitue la fin de carrière de Papy Bronson, subsiste une petite lumière, une bouée de sauvetage soit un petit film étonnant qui est tout de même loin d’être inscrit dans le panthéon de la série B.
Sorti en 1983, Ten To Midnight ( Le Justicier de Minuit en France, malins les distributeurs ) de Jack Lee Thompson est un honnête film de genre catégorie psychokiller. Ce genre assez populaire dans les années 80, vaguement inspiré du giallo, voit en général un tueur fou dont le traumatisme provient de l’enfance ( en général en rapport avec le comportement maternel ) massacrant du teenagers mâles ou femelles qui ne pensent qu’à fumer, qu’à rigoler où à faire l’amour au lieu de se mettre sérieusement à leurs études.
Ten To Midnight, s’il est loin d’être un chef d’œuvre ou un des classiques du genre, casse suffisamment de règles afin de le rendre intéressant. Ainsi, dans un premier temps, l’identité du tueur en série est révélée dès la scène inaugurale ce qui permet au réalisateur de reporter le suspense sur d’autres préoccupations comme : les victimes vont-elles échapper au tueur, le gentil flic va-t-il réussir à coincer le salopard qui charcute toutes ses filles, Charles Bronson va-t-il perdre sa légendaire moumoute pendant la course-poursuite finale, etc…. Ensuite, la part la plus importante de ce long-métrage est accordée à l’enquête menée par un Charlie Bronson dont les motivations vont le pousser à truquer des preuves afin d’assurer au criminel la condamnation la plus forte. Surfant sans honte sur la vague des Death Wish, pompant sans vergogne quelques scènes de Dirty Harry, faisant fi de ses incongruités comme un tueur en série nudiste découpant, le zguègue à l’air, de nuit et en pleine ville, des jeunes filles qui ne lui ont rien fait, Ten To Midnight reste une œuvre distrayante et parfaitement regardable dont le gros défaut est néanmoins une absence totale de second degré assumé. Alors, mesdames, messieurs, rendons grâce tout de même à Mémé Golan d’avoir permis ces quelques films noirs dont certains flirtent avec le comique involontaire et surtout d’avoir sorti de son placard ( ou de son formol c’est selon ) l’immortel Charlie Bronson.
Fabrice Simon
Bande-annonce d’Un Justicier dans la ville 2 (Death Wish 2)
Bande-annonce du Justicier de New-York (Death Wish 3)
Bande-annonce du Justicier de minuit (Ten To Midnight)
Runaway Train (1985) d’Andrei Konchalovsky
![runawaytrain_aff]()
De toutes les productions viriles du trublion Menahem Golan – toujours associé, pour l’occasion, à son cousin Yoram Globus –, Runaway Train (1985) reste sans aucun doute la plus mémorable, eu égard à l’intelligence viscérale de son script (on y reviendra) et de sa réalisation carrée, efficace, véloce malgré la pesanteur de son sujet. Jugez plutôt : des brutes épaisses (Jon Voight et Eric Roberts) s’évadent d’une prison de haute sécurité en Alaska et montent à bord d’un train que plus personne ne semble pouvoir arrêter suite à la mort subite de son conducteur. Pour compliquer le tout, le directeur de la prison, Ranken (John P. Ryan), une canaille cruelle en plein « trip » de pouvoir et qui ne vaut pas mieux que ceux qu’elle garde enfermés parfois comme des animaux, se lance à leur poursuite en hélicoptère. Bref, les uns courent après leur liberté – ou plutôt leur statut d’hommes libres –, les autres tentent de freiner, sinon l’élan des deux fuyards, au moins la course folle du convoi dont l’incontrôlable vitesse risque d’engendrer tôt ou tard une catastrophe ferroviaire et environnementale. Et entre ces deux groupes d’individus s’immisce une figure féminine, une mécanicienne providentiellement surgie d’un des wagons (Rebecca DeMornay, loin de l’aura sexy qu’elle dégageait deux ans plus tôt dans Risky Business). Du noir aux joues, les cheveux en bataille, des yeux bleus scrutant tour à tour avec inquiétude l’immensité neigeuse que transperce la locomotive et la bestialité de ses infortunés compagnons de voyage, Sara se pose comme l’élément perturbateur de cet univers masculin uniquement fait de sang, de sueur, de graisse. C’est que Runaway Train illustre avec véhémence que, pour s’en sortir dans la vie, il ne faut pas hésiter à mettre les mains dans le cambouis (les deux taulards commencent même par s’en couvrir entièrement pour mieux faire face au grand froid qui les attend hors des murs de la prison). Mais tout, dans cette histoire, est aussi affaire de mental, comme le scande, allumé d’un brin de folie furieuse aux trois-quarts du film, Oscar « Manny » Manheim (Voight), bagnard aveuglé par la haine du monde et par trois années passées enchaîné au mitard. Ce personnage antipathique, dénué d’amabilité mais fascinant, qui ne cesse de dire à son acolyte le boxeur / violeur Buck (Roberts) qu’il n’a décidément « pas de cervelle », ne cherche, au fond, qu’à passer de l’ombre à la lumière. De la noirceur d’une cellule plongée depuis des lustres dans l’obscurité à la blancheur des paysages enneigés de l’Alaska, le train fait office de fil conducteur, de véhicule vers la libération, de moyen de passage d’un état à un autre. La liberté ou la mort ? Peut-être bien les deux pour des protagonistes qui, même loin des murs de l’affreuse prison de Stonehaven, semblent toujours rester prisonniers – de la fatalité d’un système, de la dureté de l’existence. Et le film du Russe Konchalovsky de revêtir une dimension symbolique qui transcende son statut de spectacle pur et dur. Car « dur », Runaway Train peut en effet se targuer de l’être, et pas qu’à moitié !
![runawaytrain_01]()
Au train où vont les choses
Tout réflexif qu’il soit sur ce qu’on serait tenté d’appeler « la condition inhumaine » (brutalité du système carcéral, entre autres misères du monde) théâtralisée dans un environnement soumis à l’âprêté du climat hivernal, le film ne manque pas du muscle, de cette adrénaline et même, de cette sauvagerie décomplexée que le spectateur lambda est en droit d’attendre de la firme Cannon Group. Les scènes d’émeutes du début, représentatives d’un genre – le film de prison – alors florissant, accompagnées d’images pugilistiques (Roberts joue un boxeur embastillé) augurent d’une castagne ludique et véritablement cinégénique, mais surtout réaliste à faire froid dans le dos. Car loin des inepties emplies d’américanisme primaire avec Chuck Norris ou Stallone en mode Cobra, Runaway Train s’enorgueillit de la vision sèche, dépouillée, glaciale pourrait-on dire sans craindre un mauvais jeu de mot, d’un réalisateur – alors passé à l’Ouest et à Hollywood depuis quelques années – sachant aussi bien filmer les sentiments (Maria’s Lovers) que l’action sans concession. Plus tard, l’homme se montrera plus ostentatoire, moins profond aussi et probablement perverti par la tendance, avec un Tango & Cash énergique et « mâle », mais tout juste divertissant. Pas d’humour, ou si peu, dans Runaway Train. Pas beaucoup d’espoir non plus. À croire que l’économie de moyens du métrage déteint sur l’atmosphère quelque peu austère, dure, du métrage. Doté d’un budget de série B (9 millions de dollars ; même pour l’époque, ça n’était pas faramineux), Konchalovsky livre une vraie série A, sans réels coups d’éclat de destruction massive ni de grandes envolées pyrotechniques (les effondrements craints n’ont pas lieu et le crash final n’est pas montré) mais avec un sens du montage, de la confrontation (duel de grandes gueules, triangle émotionnel Manny-Buck-Sara, face-à-face violents, parfois scatologiques, entre tous les hommes de l’histoire) et du huis-clos à peine entâché dans sa subtilité par d’obligés – et prévisibles – plans du train filant à toute allure à travers les montagnes et les sapinières. Des vignettes attendues mais somme toutes représentatives d’un spectacle grandeur nature. On pourrait même dire que le « sujet ferroviaire » possède quelque chose de matriciel vis-à-vis du 7e art (après tout, les rails permettent le travelling…), si l’on se rappelle l’un des vrais premiers films de l’histoire du cinématographe, L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat des frères Lumière (1895). Mais restons concrets. À travers le fil de ses événements et de ses mouvements de caméra (Konchalovksy filme sans à-coups, avec énergie et précision), Runaway Train franchit une frontière des genres, passant de l’action brute et du « film de prison » à un cinéma de la grande aventure humaine. Le tout, sur fond de conflit intérieur, permanent, entre force physique et force psychique.
![runawaytrain_02]()
« Pas une bête : un humain »
Loin des archétypes testostéronés de la décennie à laquelle appartient le film, John Voight incarne, comme Eastwood ou Bronson l’auraient fait au sommet de leur carrière épique, un taulard dopé à l’amertume et au désespoir mais, paradoxe délectable, rageusement cramponné à un désir de liberté. À tel point qu’il serait prêt à en mourir, disons-le, « héroïquement ». En témoigne, l’intensité dramatique du finale où, tandis qu’en fond sonore se joue le Gloria en ré majeur de Vivaldi, notre Manny se tient debout, les bras levés vers le ciel en guise de victoire contre un système qui a tenté de le broyer, inébranlable sur le toit de la locomotive alors sur le point de s’écraser. Un dur-à-cuire, cet Oscar Manheim. Une figure tragique, attristante et effrayante aussi, engluée jusqu’à l’aliénation dans la violence, l’idée de revanche (sur la vie, et tout le reste) et l’incapacité de réhabilitation… L’acteur s’est paraît-il préparé pour son interprétation en passant quelque temps dans la prison d’État de San Quentin, où il se serait lié d’amitié avec des détenus. Chose certaine, il semble véritablement habité par son rôle et sa prestation (récompensée par un Golden Globe en 1986) inquiète plus qu’elle n’amuse, au point de susciter chez le spectateur un sentiment de vide et de malaise. C’est que plane aussi sur ce récit (d’après un script original d’un certain… Akira Kurosawa), l’ombre d’un autre ex-taulard, un vrai celui-là, nommé Edward Bunker. Coscénariste du film, cet auteur de polars brutaux (également acteur à ses heures, notamment chez Tarantino ; souvenez-nous du Mister Blue de Reservoir Dogs) est le signataire d’une série de romans dépeignant l’univers pénitientaire et l’impossible réinsertion de criminels endurcis par leurs séjours en QHS. En plus d’interpréter ici l’un des codétenus de Manny (le chauve et bagarreur Jonah), il imprègne, par sa plume, le métrage de Konchalovksy de toute cette lucidité saisissante, cette bestialité unique qu’une production typiquement eighties aurait, en d’autres circonstances d’écriture, forcément nivelée par le bas et l’humour. D’où ce tourment très particulier que dégagent les dernières images du métrage, tandis que défile une citation extraite de Richard III de Shakespeare, énoncé dont les mots initiaux donnent justement son titre au premier roman noir de Bunker : No Beast So Fierce (publié sous le titre Aucune bête aussi féroce dans nos contrées). Comme quoi, un film n’est jamais bon par hasard.
Stéphane Ledien
Comme évoqué en introduction, c’est sur la croisette que les pontes de la Cannon Group se sont illustrés. Petite évocation de souvenirs festivaliers de Jean-Charles Lemeunier.
Menahem Golan vient de disparaître, le 8 août dernier à Tel Aviv, à l’âge de 85 ans. Ce producteur, réalisateur et scénariste israélien avait réussi à conquérir le marché américain en rachetant, avec son cousin Yoram Globus, une petite compagnie qui vivotait. Ils en firent la légendaire Cannon Films (ou Cannon Group). Du baston au film d’auteur, la Cannon a grandi au point de débarquer au festival de Cannes dans les années quatre-vingt et d’y tenir une place importante pendant plusieurs années.
Si Yoram Globus, d’une quinzaine d’années le cadet de son cousin, avait un physique rappelant les ténors du Nouvel Hollywood (silhouette svelte et barbe noire), Menahem Golan cultivait son look de nabab replet parlant l’anglais avec un accent prononcé, à la manière des moguls de l’âge d’or, Sam Spiegel, Carl Laemmle, Nick Schenck et autres.
Une année, la Cannon décida d’envahir Cannes et le jeune festivalier que j’étais alors s’en souvient avec émotion. Tous les matins, les journaux corporatistes récoltés dans les grands hôtels (Screen, Variety, Hollywood Reporter, Business) offrait un encart cartonné qu’on ne pouvait pas louper, sélection d’affiches de longs-métrages présentés au Marché du film ou n’existant pas encore et sans doute jamais tournés. On feuilletait les pages de cet encart pour voir apparaître les visages des "stars", non seulement les Stallone, Norris, Van Damme, Dudikoff mais aussi Sho Kosugi, Lucinda Dickey ou les frères Paul. C’était les années fastes, au cours desquelles la société gagna des galons au point d’accéder aux sections parallèles du festival (La rue à la Quinzaine des Réalisateurs, par exemple) et même à la compétition officielle (grâce à Konchalovsky).
![Golan Chuck Norris (Photo JCL)]()
J’ai gardé un souvenir fort du Bayou et de son incroyable premier plan séquence et surtout du fantastique Tough Guys Don’t Dance (Les vrais durs ne dansent pas, projeté hors compétition). Écrivain de talent, Norman Mailer était un tout aussi bon cinéaste et l’emploi de l’impressionnant Lawrence Tierney (le Dillinger de 1945) face à Ryan O’Neal et Isabella Rossellini mettait encore plus de poids dans la balance. Ce n’est sans doute pas un hasard si, cinq ans plus tard, Tarantino réutilise Tierney dans un rôle de gangster qui lui colle à la peau.
Un jour, Yoram ou Menahem (mais je penche plutôt pour le second) eut une idée de génie : organiser autour de films de seconde zone, réelle marque de fabrique de la Cannon, des conférences de presse champagne. La plupart du temps, les produits en question n’étaient qu’à l’état de projets et, outre l’affiche, le titre et le ou les vedettes présumées, les crédits ne signalaient aucun autre contrat, ni de scénariste ni de metteur en scène. Ces rendez-vous étaient annoncés par voie de presse et par tracts distribués dans la rue devant le Carlton, où ils se déroulaient. Contrairement aux conférences de presse officielles du palais des festivals, celles-ci étaient plus facilement accessibles.
![Golan Michael Madsen (Photo JCL)]()
Séquence frissons : je me souviens d’avoir vu ainsi Chuck Norris. Michael Dudikoff. Dolph Lundgren. Joan Collins et Roger Moore et Michael Winner ensemble, pour un film qui ne verra jamais le jour avec ce casting. Peut-être s’agissait-il de Bullseye !, qui réunit Roger Moore devant et Michael Winner derrière la caméra. Dans ce cas-là, Joan Collins a du être remplacée par Sally Kirkland. Souvenir également d’avoir raté (et je m’en veux encore) Maruschka Detmers. Elle venait sans doute parler de Hanna’s War (1988), un film réalisé par Menahem.
Les journalistes entraient dans une vaste salle et prenaient en passant une coupe de champagne (il y en avait à profusion sur une table). Comme l’attente durait, ils se relevaient et allaient en chercher une autre, puis une autre, puis… bon, enfin, faut pas rigoler, il s’agissait de professionnels de la profession, des gens sérieux, quoi ! Finalement, Menahem arrivait avec son ou ses invités. Il prenait longuement la parole pour présenter sa vedette et parler de son projet. Le ton était souvent paternaliste, d’autant plus si l’acteur à ses côtés était un petit jeune, style Dudikoff. Il ne fallait pas, exhortait-il les journalistes, avoir la dent trop dure avec son poulain. Ceux-là ne pipaient mot, se contentant de savourer leur boisson pétillante et, quand venait le temps des questions, c’était toujours la bonne humeur qui présidait.
![Golan Sean Young (Photo JCL)]()
À Cannes, Golan était omniprésent, organisant chaque année quantité de festivités en marge de la manifestation, chaque fois avec des acteurs qui attiraient les photographes. Que dire de la fois où, sur le toit du palais Croisette qui abritait la Quinzaine des Réalisateurs, il avait fait venir Martin Landau, Michael Madsen et Sean Young ? Je n’ai pas réussi à retrouver pour quel film le producteur avait réuni ce beau trio. Peut-être lui non plus n’a-t-il jamais été réalisé, en tout cas pas avec ce casting.
Un dernier petit souvenir. Je marche le long de la Croisette, pressé de me rendre à une projection, et, au niveau du Carlton, j’aperçois Menahem Golan en survêtement, pratiquant son jogging. Il ne doit pas être loin de six heures du soir, horaire symbolique où les sommités du septième art sont en train d’enfiler leurs smoking et robe de soirée. Rougi par l’effort, Menahem, lui, court tranquillement et se fait en même temps interviewer. Oui, vous avez bien lu. Pendant qu’il trottine, il a obligé une jolie et jeune journaliste à galoper à ses côtés, encombrée d’un micro, de notes, de dossiers de presse. Tout cela sous les yeux de milliers de passants. Si ce n’est pas la classe, ça !
Puis, une année, la Cannon a disparu au profit de la 21st Century. Le bon temps était passé, les petits fours furent rentrés, le champagne rebouché et le festival continua à égrener les années, laissant dans les mémoires cinq ou six ans de luxe et de paillettes hollywoodiennes dignes de l’Âge d’or.
Jean-Charles Lemeunier
![]()
![]()